Agoraphobie, guide pour démarrer
L'agoraphobie, qu'elle soit associée ou non à des attaques de panique ou de l'anxiété généralisée peut avoir un retentissement important sur la vie de personne touchée. Elle peut s'installer insidieusement et conduire à une sorte d'enfermement progressif, jusqu'au moment où les conséquences deviennent trop lourdes à porter. Comment la comprendre et comment y remédier ? Voici des réponses à ces deux questions, dans cet article dont le but est de vous apporter une compréhension globale du problème et des solutions qui s’offrent à vous.
.png)
Cet article ne remplace pas un échange avec un professionnel.
Contactez un professionnel (prendre contact).
Composez les numéros d'urgences
Qu’est-ce que l’agoraphobie ?
L’agoraphobie est un trouble anxieux qui se manifeste par une peur intense de se retrouver dans des situations où il serait difficile de s’échapper ou d’obtenir de l’aide en cas de malaise, de panique ou de détresse.
Ces situations sont souvent des lieux du quotidien : transports en commun, centres commerciaux, espaces ouverts, cinémas, files d’attente, parkings souterrains, ou encore le simple fait d’être seul(e) à l’extérieur de chez soi.
Ce n’est donc pas « la peur de la foule » à proprement parler, mais plutôt la peur d’être piégé(e), sans issue ni sécurité, dans un endroit perçu comme dangereux pour soi.
Et que se passe-t-il face aux situations redoutées ?
Quand la personne est confrontée à ces contextes, une montée brutale d’anxiété se produit : sensation de panique, vertiges, sueurs, palpitations, envie de fuir.
Souvent, cette peur devient si forte que la personne finit par éviter progressivement ces lieux, ou ne s’y rend qu’accompagnée.
Sur le moment, cela procure un soulagement immédiat, mais à long terme, l’évitement renforce la peur.
C’est ce que j’observe souvent en cabinet : plus on évite une situation, plus elle nous paraît menaçante… et plus on se sent incapable d’y faire face.
Une conséquence fréquente…
Avec le temps, le champ des évitements s’élargit : on commence par éviter les grands magasins, puis les trajets en transports, puis les sorties plus lointaines… jusqu’à parfois se retrouver confiné(e) chez soi.
Cela s’accompagne d’une perte de confiance et d’un sentiment d’enfermement, parfois d’une dépendance affective ou matérielle vis-à-vis de l’entourage.
Beaucoup de personnes me disent :
« J’ai l’impression que ma vie s’est rétrécie sans que je m’en rende compte. »
Ce trouble peut s’installer insidieusement, souvent à la suite d’attaques de panique, d’un stress prolongé ou d’un traumatisme.
Tout comprendre rapidement en 4 vidéos :
Découvrez dans ces 4 courtes vidéos ce qui provoque l’agoraphobie, pourquoi elle peut devenir si envahissante et comment il est possible de s’en libérer durablement, grâce à une approche humaine, rationnelle et structurée.
→ [S’inscrire pour voir les 4 vidéos]
Symptômes de l’agoraphobie
Les symptômes de l’agoraphobie varient d’une personne à l’autre, mais suivent un schéma commun : une peur disproportionnée de certaines situations et une tendance à l’évitement qui finit par structurer la vie quotidienne.
Parmi les manifestations les plus fréquentes, on retrouve :
- une peur intense ou une anxiété anticipatoire à l’idée de se retrouver dans des lieux publics ou bondés ;
- une sensation de perte de contrôle ou de panique imminente ;
- des symptômes physiques tels que vertiges, palpitations, tremblements, nausées, oppression respiratoire ou douleurs thoraciques ;
- un besoin de réassurance constant (être accompagné(e), garder un téléphone sur soi, repérer les sorties ou les “issues de secours”) ;
- des routines d’évitement : ne plus conduire, refuser certaines invitations, limiter les trajets ou travailler à domicile.
Ces symptômes sont souvent épuisants.
Ils finissent par affecter la liberté, la vie sociale et professionnelle, et génèrent un sentiment d’injustice ou d’incompréhension :
« Je sais que ce n’est pas rationnel, mais je ne peux pas m’en empêcher. »
Point de vigilance
Avant de poser un diagnostic d’agoraphobie, il est important d’écarter d’autres causes médicales ou psychologiques.
C’est pourquoi un bilan médical initial est souvent nécessaire.
Agoraphobie : qui est touché ?
L’agoraphobie touche environ 1 à 2 % de la population au cours de la vie.
Elle apparaît le plus souvent à l’adolescence ou au début de l’âge adulte, mais peut aussi survenir plus tard, notamment après un épisode de stress majeur ou une succession d’attaques de panique.
Les femmes sont environ deux fois plus nombreuses à en souffrir que les hommes.
Cette différence s’explique en partie par des facteurs biologiques, hormonaux et socioculturels, mais aussi par le fait que les femmes consultent plus fréquemment et parlent davantage de leurs difficultés.
Ce trouble est souvent sous-diagnostiqué, car beaucoup de personnes pensent qu’elles souffrent simplement de timidité, d’un manque de confiance en soi ou d’un épuisement nerveux.
En réalité, il s’agit d’un mécanisme anxieux précis, qui s’entretient avec le temps si rien n’est mis en place pour le désamorcer.
Dans ma pratique, je vois régulièrement des personnes qui ont mis des années à consulter.
Elles ont appris à contourner le problème — en évitant les transports, les centres commerciaux, les voyages — jusqu’à ce que cela devienne invivable.
« Je n’ai pas l’impression de vivre, mais de survivre à l’intérieur d’un périmètre de plus en plus petit. »
La bonne nouvelle, c’est que l’agoraphobie se soigne très bien, surtout lorsque la prise en charge est spécifique et structurée.
Plus le trouble est pris tôt, plus la récupération est rapide.
Vous pouvez en savoir plus avec les vidéos que j'ai mises en ligne sur ce sujet.
Attaques de panique ≠ Agoraphobie
L’agoraphobie et les attaques de panique sont souvent confondues, car elles se manifestent toutes deux par des crises d’anxiété aiguë.
Mais il s’agit de deux troubles distincts, qui peuvent exister ensemble ou séparément.
L’attaque de panique est un épisode bref de peur intense accompagné de symptômes physiques très marqués : palpitations, sueurs, étourdissements, oppression, impression de “devenir fou” ou de “perdre le contrôle”.
Ces crises peuvent survenir dans n’importe quelle situation, parfois même sans cause apparente.
L’agoraphobie, elle, n’est pas une crise, mais une peur persistante de certaines situations où une attaque de panique pourrait se produire — ou, plus largement, où il serait difficile d’obtenir de l’aide.
Autrement dit, l’agoraphobie, c’est fondamentalement "la peur d’avoir peur".
C’est cette peur par anticipation qui pousse la personne à éviter certains lieux ou contextes, jusqu’à restreindre peu à peu son champ de vie.
Il est donc tout à fait possible :
- de faire des attaques de panique sans souffrir d’agoraphobie ;
- ou de souffrir d’agoraphobie sans faire de vraies attaques de panique, mais en vivant une peur constante de “ne pas pouvoir s’en sortir”.
Dans la majorité des cas, les deux troubles se nourrissent mutuellement.
Une première attaque de panique vécue dans un lieu public peut suffire à créer une mémoire de peur, et donc un évitemment durable de ce lieu — c’est souvent le point de départ de l’agoraphobie.
Diagnostic : Agoraphobie vs Trouble panique vs TAG
Le diagnostic de l’agoraphobie repose sur des critères bien établis.
Selon le DSM-5-TR et la CIM-11 (OMS), il faut que la personne ressente une peur intense ou de l’anxiété dans au moins deux situations parmi les suivantes :
- utiliser les transports en commun ;
- se trouver dans des espaces ouverts (parking, place, grand magasin) ;
- se trouver dans des lieux clos (cinéma, ascenseur, métro) ;
- faire la queue ou se trouver dans la foule ;
- être seul(e) à l’extérieur de son domicile.
Ces situations provoquent une anxiété disproportionnée, qui conduit à l’évitement ou à la nécessité d’être accompagné(e) pour y faire face.
Les symptômes durent au moins six mois et entraînent une altération significative de la vie quotidienne (sociale, professionnelle ou familiale).
Différences entre agoraphobie, trouble panique et anxiété généralisée
- Agoraphobie : la peur concerne les situations, souvent par crainte de perdre le contrôle, de ne pas pouvoir s’échapper ou d’être seul(e) en cas de malaise.
- Trouble panique : le cœur du trouble, c’est la répétition d’attaques de panique, accompagnées d’une peur constante d’en revivre une nouvelle.
- Trouble anxieux généralisé (TAG) : l’anxiété est diffuse et chronique, non liée à des lieux précis, mais centrée sur des préoccupations permanentes (travail, santé, relations, avenir…).
En pratique, ces troubles se recoupent fréquemment.
De nombreuses personnes souffrant d’agoraphobie ont également connu des attaques de panique ou présentent un terrain anxieux généralisé.
C’est pourquoi il est important de consulter un professionnel formé à ces distinctions, afin de bénéficier d'une prise en charge adaptée.
Liens utiles :
→ Pour en savoir plus les attaques de panique.
→ Pour en savoir plus sur le trouble anxieux généralisé.
Vivre avec l’agoraphobie…
l'agoraphobie est une épreuve qui peut rester longtemps invisible au yeux des autres...
Pour ceux qui n’en souffrent pas, il est souvent difficile de comprendre ce que cela signifie de se sentir prisonnier de ses peurs.
Et pour ceux qui la vivent au quotidien, c’est souvent une lutte silencieuse, faite de honte, de solitude et de culpabilité.
« J’aimerais pouvoir sortir sans réfléchir, sans plan B, sans angoisse… juste comme avant. »
Ce trouble s’accompagne très souvent d’un sentiment de dévalorisation :
La personne sait que sa peur est excessive, mais elle ne parvient pas à la contrôler.
Elle se reproche de “ne pas être normale”, de “se compliquer la vie”, ou d’“en faire trop”.
Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire comme les autres ?
L’entourage peut parfois mal interpréter ce qu’il voit...
Dans certains cela peut conduire à des jugements :
- "Manque de volonté"
- "Manque d'effort"
- "Caprices"
- "Manque de courage"
- Etc.
Or, rien n’est plus faux :
La personne agoraphobe fait déjà énormément d’efforts pour garder une vie à peu près fonctionnelle.
Dans les formes plus sévères, l’agoraphobie peut entraîner :
- une restriction drastique du périmètre de vie (jusqu’à ne plus quitter son domicile) ;
- une dépendance émotionnelle ou matérielle à des proches ;
- un isolement social profond et un risque accru de dépression.
Dans ma pratique, j’observe souvent une chose :
Les personnes agoraphobes sont épuisées, non seulement par la peur, mais aussi par l’énergie déployée pour la cacher.
Cette fatigue psychique, associée à la honte, peut les couper des autres et les enfermer davantage.
C’est pour cette raison qu’il est essentiel de ne pas rester seul(e).
S’entourer de personnes qui comprennent le problème, rejoindre un groupe d’entraide ou entamer une thérapie adaptée est souvent la première étape vers la libération.
« L’agoraphobie ne définit pas qui vous êtes. Elle traduit simplement des peurs profondes et un état d’épuisement de votre système de sécurité intérieur »
Évolution possible (et troubles associés)
Sans prise en charge adaptée, l’agoraphobie a tendance à s’étendre et à se chroniciser.
Au départ, elle se limite à certaines situations précises : prendre le métro, aller au supermarché, assister à un événement.
Mais petit à petit, ces évitements se multiplient.
Le monde extérieur devient perçu comme imprévisible et dangereux, tandis que le domicile semble le seul lieu “sûr”.
C’est souvent à ce moment-là que le trouble commence.
Une évolution progressive
Il va ensuite porgressivement impacter la vie quotidienne, jusqu'à dans certains cas empêcher complètement la personne de "vivre".
Certains cessent de travailler, d’autres déclinent les invitations, renoncent à des déplacements ou à des voyages, auxquels ils tenaient pourtant.
L’isolement s’installe, accompagné d’un sentiment de honte et d’incompréhension.
Cela peut aller jusqu'à une agoraphobie sévère, avec quasi-impossibilité de sortir de chez soi (sans être accompagné).
D'autres troubles peuvent s'associer
L’agoraphobie peut également s’accompagner ou évoluer vers d’autres troubles anxieux :
- le trouble panique, quand des attaques surviennent de manière répétée ;
- le trouble anxieux généralisé (TAG), quand l’anxiété devient diffuse et permanente ;
- ou encore des phobies spécifiques (claustrophobie, phobie sociale).
Avec le temps, la fatigue psychologique et la tension constante favorisent aussi l’apparition de symptômes dépressifs, voire d’un "burn-out anxieux".
Dans ma pratique, je remarque souvent que cette dépression n’est pas une cause, mais une conséquence de la peur et de l’épuisement qu’elle engendre.
Autrement dit :
Ce n’est pas parce qu’on est déprimé qu’on devient agoraphobe, mais souvent parce qu’on est agoraphobe qu’on finit par s’épuiser émotionnellement.
Un processus entièrement réversible
La bonne nouvelle, c’est que le processus est entièrement réversible !
Avec une approche thérapeutique ciblée et progressive, il est tout à fait possible de retrouver une vie normale, de reprendre confiance et de réinvestir le monde extérieur à son rythme.
📍 Pour en savoir plus sur les moyens de s’en sortir :
→ [Voir les 4 vidéos explicatives]
Quelles sont les causes de l’agoraphobie (et ce qui l’entretient) ?
Il n’existe pas une cause unique. L’agoraphobie résulte le plus souvent d’un enchevêtrement de facteurs : terrain anxieux, épisodes de stress, expériences de panique, apprentissages (conscients ou non) et habitudes de sécurité qui, à force de soulager sur le moment, amplifient le problème sur la durée.
Ce que dit la recherche (version simple et utile)
- Le cerveau associe certains lieux ou situations (métro, centre commercial, file d’attente, tunnel…) à un danger : c’est un apprentissage. Après une première montée d’angoisse ou une crise, il « mémorise » que ce contexte = risque.
- Les évitements (ne plus y aller) et les comportements de sécurité (y aller uniquement accompagné(e), s’asseoir près d’une sortie, garder de l’eau/du sucre/une appli SOS) soulagent à court terme… mais confirment à ton cerveau que le lieu était dangereux. Résultat : la peur augmente à long terme.
- La peur de la peur (anticipation) entretient un cercle vicieux : vigilance corporelle → interprétations catastrophiques (« si je m’évanouis », « si je reste bloqué(e) ») → montée d’adrénaline → confirmation de la menace.
- La sensibilité aux sensations (vertiges, oppression, chaleur…) et l’hypercontrôle (scanner les issues, surveiller la fréquence cardiaque, planifier un “plan B”) renforcent la boucle anxieuse.
En d’autres termes :
Développer l'évitement rend meilleur pour éviter, mais moins libre pour vivre.
Ce que j’observe en pratique (retour du cabinet)
- Les déclencheurs sont parfois très subtils : un couloir étroit, un bruit de ventilation, une lumière agressive, un trajet précis, un moment de la journée.
- Les rituels de sécurité peuvent se cumuler : « j’y vais seulement si… » (si quelqu’un m’accompagne, si j’ai pris tel objet, si je peux m’asseoir près d’une sortie, si je n’ai pas mangé, si je peux annuler au dernier moment…).
- À force, la personne réduit son périmètre et perd confiance. Elle a l’impression d’être « fragile », alors qu’en réalité, elle a surtout entraîné son cerveau à confondre inconfort et danger.
- Des tramatismes, souvent inconscients, sont à la racine de ces troubles.
Les mécanismes qui entretiennent la peur (le “moteur” de l’agoraphobie)
- Évitement systématique : ne pas y aller du tout (soulagement immédiat → renforcement durable de la peur).
- Réassurance externe : n’y aller qu’accompagné(e), appeler quelqu’un, garder des objets « sauveurs » (eau, barres sucrées, spray…), vérifier à l’avance les sorties/itinéraires.
- Contrôle excessif : scanner sans cesse son corps (pouls, souffle), contrôler la température, la position, l’itinéraire « parfait ».
- Anticipation et ruminations : rejouer le pire scénario, « et si… ? », planifier dix issues de secours.
- Auto-jugement : se traiter de « faible », se forcer ou se punir après une difficulté — ce qui augmente la pression et la peur.
Point clé :
Ces stratégies marchent à court terme… et alimentent le trouble à long terme.
Traumatismes et croyances négatives (quand le passé s’invite dans le présent)
Chez beaucoup de personnes, on retrouve des expériences marquantes (parfois anciennes ou minimisées) qui ont laissé des croyances du type :
- « Je ne suis pas capable » ;
- « Je vais perdre le contrôle » ;
- « Personne ne m’aidera » ;
- Etc.
Mais certaines de ces croyances peuvent même être inconscientes car elles sont liées à des traumas profondément enfouis du fait de leur ancienneté.
En effet, tous les être humains, en se développant, passent (notamment lors de la prime enfance) par certains traumas "incontournables".
Ces traumatismes ne sont pas forcément liés à des événements spectaculaires ou particulièrement dangereux. C'est pourquoi ils peuvent être totalement inconscients.
📍 Pour en savoir plus sur ces questions :
→ [Voir les 4 vidéos explicatives]
Ne pas oublier le contexte et l’hygiène de vie
Le manque de sommeil, les stimulants (café, boissons énergisantes), une alimentation déséquilibrée, la sédentarité ou un stress relationnel soutenu baissent le seuil de tolérance aux sensations et majorent l’anxiété.
Ce ne sont pas des causes uniques, mais plutôt des facteurs qui vont jouer dans un sens ou dans l'autre.
Dans quels cas consulterpout de l'agoraphobie ?
Plus on agit tôt, plus le chemin vers la guérison est simple.
La majorité des personnes qui consultent pour une agoraphobie me disent la même chose :
« Si j’avais su que ça se soignait aussi bien, je serais venu(e) bien plus tôt. »
Il ne faut donc pas attendre d’être “au bout du rouleau” pour consulter.
Dès les premières limitations (refuser une invitation, éviter certains lieux ou trajets par exemple), il est important d’en parler à un professionnel.
👉 Consultez si :
- vos peurs ou évitements commencent à vous empêcher de vivre certaines activités importantes (travail, études, loisirs, famille) ;
- vous commencez à ressentir une angoisse disproportionnée dans des situations neutres pour les autres ;
- vous avez déjà eu des attaques de panique liées à la peur de sortir ou de vous retrouver coincé(e) quelque part ;
- ou tout simplement si vous sentez que votre espace de vie se rétrécit.
Il existe aujourd’hui des approches thérapeutiques efficaces, validées scientifiquement et éprouvées dans la pratique clinique.
Et ce n’est jamais trop tard pour agir.
Même après des années de repli, des améliorations spectaculaires sont possibles, à condition d’un accompagnement adapté, méthodique et progressif.
Persévérez, même si le chemin semble difficile
Les progrès ne sont pas toujours linéaires, mais ils sont réels.
Chaque sortie, chaque exposition réussie, chaque sensation supportée est une victoire pour le cerveau, qui réapprend peu à peu que “le danger n’est plus là”.
La peur n’est pas une fatalité.
C’est une réaction qui peut être reprogrammée, avec patience et méthode.
Que faire en cas d’urgence ?
En cas de détresse aiguë, d’idées suicidaires, ou de symptômes physiques nouveaux ou inquiétants, il faut consulter sans attendre :
- appelez le 15 (Samu) ou le 3114 (numéro national de prévention du suicide) en France ;
- contactez votre médecin traitant ou votre service d’urgence habituel ;
- prévenez le psychologue ou psychiatre qui vous suit si vous êtes déjà accompagné(e).
Une fois le moment de crise passé, il est important de reprendre contact avec un professionnel formé aux troubles anxieux, pour comprendre ce qui s’est joué et prévenir les récidives.
L’urgence, ce n’est pas seulement quand “on n’en peut plus” : c’est aussi quand la peur commence à diriger votre vie à votre place.
Que faire pour se libérer de l’agoraphobie ?
Se libérer de l’agoraphobie ne se fait pas en “chassant” la peur, mais en rééduquant le cerveau à ne plus l’entretenir.
C’est un processus qui repose sur trois piliers indissociables : comprendre, apprendre à gérer, traiter.
Ces trois dimensions se renforcent mutuellement : comprendre ce qui se passe en vous aide à mieux gérer ; mieux gérer permet de travailler sur les causes profondes ; et traiter les causes consolide les changements.
1️⃣ Comprendre
La première étape, c’est de comprendre ce qu’il vous arrive, sans culpabilité.
L’agoraphobie n’est pas une faiblesse, ni un défaut de caractère : c’est un système d’alarme hyperactif.
Votre cerveau a simplement “mal appris” à reconnaître le danger réel du danger imaginaire.
En thérapie, on commence donc par une psychoéducation claire : comment fonctionne l’anxiété, ce qu’est une attaque de panique, pourquoi les évitements entretiennent le trouble, et surtout comment tout cela peut se désamorcer.
Comprendre, c’est déjà reprendre un peu de pouvoir sur la peur.
2️⃣ Apprendre à gérer la peur
Une fois que vous comprenez le mécanisme, vient le temps de réapprendre à gérer vos sensations et vos pensées.
Cela ne veut pas dire “ne plus avoir peur”, mais savoir quoi en faire.
On travaille alors sur :
- la régulation du stress (respiration, pleine conscience, ancrage corporel) ;
- la tolérance aux sensations (accepter d’avoir le cœur qui bat sans y voir un danger) ;
- la désensibilisation progressive aux situations évitées (exposition graduée) ;
- la réduction des comportements de sécurité (ces “béquilles” qui entretiennent la dépendance).
Les progrès se construisent pas à pas, avec un plan clair, progressif et mesurable.
Chaque étape franchie solidifie la suivante.
Dans ma pratique, j’observe que les personnes qui apprennent à accueillir leurs sensations plutôt qu’à les combattre progressent plus vite.
Elles découvrent que la peur n’a plus besoin d’être éliminée, seulement comprise et traversée.
3️⃣ Traiter les causes profondes
L’agoraphobie ne vient jamais de nulle part.
Derrière la peur des lieux, on retrouve souvent des expériences émotionnelles non digérées, parfois très anciennes, qui ont laissé des croyances du type :
« Je ne suis pas capable », « je vais perdre le contrôle », « je ne peux pas compter sur les autres ».
Quand c’est le cas, il devient essentiel de travailler ces racines émotionnelles.
Des approches comme l’EMDR ou la thérapie des schémas permettent de retraiter ces expériences et de réduire la vulnérabilité anxieuse de fond.
Cela ne remplace pas le travail comportemental, mais le complète :
quand les causes sont apaisées, l’exposition devient plus fluide, et les rechutes beaucoup plus rares.
En combinant ces trois axes — compréhension, gestion, traitement — dans une démarche structurée et cohérente, on obtient les meilleurs résultats :
les progrès deviennent durables, la peur perd sa force, et la confiance revient.
Le but n’est pas de ne plus avoir peur, mais de ne plus en être prisonnier.
📍 Pour découvrir concrètement cette approche (et comment la mettre en œuvre) :
→ [Voir les 4 vidéos explicatives]
Quelles thérapies ont fait leurs preuves pour traiter l’agoraphobie ?
Une bonne nouvelle : l’agoraphobie se soigne bien, à condition d’utiliser une méthodologie adaptée.
Parmi toutes les approches certaines sont nettement mieux documentées que d’autres.
Je vous propose de commencer parc es approches.
D'autres articles viendrons ensuite.
Les Thérapies Cognitives et Comportementales (TCC)
Les TCC sont le traitement de référence pour l’agoraphobie (de même que pour le trouble attaques panique ou l'anxiété généralisée).
Elles ont fait la preuve de leur efficacité dans de nombreuses études cliniques, et sont recommandées en première intention par la plupart des autorités de santé (NICE, OMS, HAS…).
Leur objectif : comprendre, confronter et désamorcer la peur, étape par étape.
En pratique, les TCC combinent plusieurs axes :
- Psychoéducation : comprendre les mécanismes de la peur et du conditionnement ;
- Travail cognitif : repérer et corriger les pensées catastrophiques (« si je perds connaissance, si je ne peux pas fuir… ») ;
- Expositions graduées : réapprendre à affronter les situations évitées, avec des exercices progressifs et mesurables ;
- Prévention de la rechute : consolider les acquis et restaurer la confiance à long terme.
L’exposition est la pierre angulaire du traitement : c’est elle qui “désactive” le signal de danger erroné enregistré par le cerveau.
La recherche montre que les TCC peuvent se pratiquer en cabinet, en groupe, à distance (visio) ou via des programmes en ligne.
La thérapie EMDR (en complément ciblé)
L’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) n’est pas un traitement de première intention pour l’agoraphobie, mais elle s’avère très utile en complément.
L’objectif de l’EMDR est d’aider le cerveau à “digérer” ces souvenirs émotionnels pour qu’ils cessent d’alimenter la peur.
En diminuant l’intensité émotionnelle de ces expériences, on facilite le travail d’exposition et on réduit le risque de rechute.
Dans ma pratique, j’utilise l’EMDR pour lever des blocages émotionnels qui empêchent le patient d’avancer malgré sa bonne compréhension du problème.
Je combine cela avec une approche intégrative qui combine des techniques issues des TCC avec encore d'autres approches.
Mais la base de ce travail consiste à combiner le travail comportemental (TCC) avec le travail émotionnel (EMDR) : c’est cette combinaison qui offre les résultats les plus complets et durables.
Les autres approches
Certaines méthodes peuvent apporter un soutien complémentaire, surtout dans la gestion des émotions :
- Mindfulness (pleine conscience) : utile pour l’observation détachée des sensations et la réduction de la rumination ;
- Cohérence cardiaque, relaxation, hypnose : aident à diminuer la tension physiologique ;
- EFT, TIPI, sophrologie : outils parfois intéressants pour réapprendre à accueillir les ressentis.
Mais ces approches ne remplacent pas un traitement structuré : elles viennent en soutien, pour améliorer le confort émotionnel ou consolider le travail thérapeutique de fond.
Quel format de thérapie choisir (cabinet ou à distance ?)
Les études menées en TCC montrent que les résultats sont comprarables entre :
- Thérapie en cabinet
- Thérapie en visio
- Thérapie à l'aide de programme à distance (en ligne)
Ce qui est important semble être le fait que le protocole soit bien structuré et que la patient, une fois le travail commencé ai envie de continuer.
En finalité, ce qui soigne, ce n’est pas une technique isolée, mais la façon dont elle est mise en œuvre, dans un cadre sûr et structuré, ainsi que la façon dont elle combinée avec d'autres.
📍 Pour comprendre comment on peut combiner ces approches :
→ [Voir les 4 vidéos]
Médicaments et agoraphobie
Selon les recommandations actuelles (NICE, OMS, HAS, Cochrane), les médicaments peuvent être proposés dans certains cas d’agoraphobie, mais ils ne constituent jamais le cœur du traitement.
Ils peuvent être utiles pour stabiliser les symptômes, notamment lorsque la peur ou les crises sont trop envahissantes pour permettre d’engager rapidement un travail psychothérapeutique.
Le médicament peut être un “appui temporaire”, mais la psychothérapie reste la clé pour arriver à des changements durables.
Quels médicaments peuvent être prescrits ?
Le type de molécule peut varier, mais on retrouv essentiellement trois types.
1. Les antidépresseurs de la famille des ISRS ou IRSN
Ce sont les molécules les plus utilisées pour les troubles anxieux (comme la sertraline, la paroxétine ou la venlafaxine).
Leur objectif est de réduire l’hyperactivité du système nerveux et d’abaisser le seuil d’anxiété.
Les effets apparaissent progressivement (souvent après 2 à 4 semaines), et le traitement doit être supervisé médicalement.
2. Les anxiolytiques (benzodiazépines)
Ils peuvent aider en phase aiguë, lorsque la panique est trop intense.
Mais leur utilisation doit rester limitée dans le temps (quelques semaines maximum), car ils comportent un risque d’accoutumance et de dépendance.
3. Les neuroleptiques ou sédatifs
Dans certains cas particuliers, ils peuvent être prescrits en appoint et à faibles doses, mais ils ne sont pas indiqués en première ligne pour les troubles anxieux.
Ce que montre la recherche
Les études comparatives confirment que, sur le long terme, la thérapie seule (notamment les TCC) conduit à des résultats plus durables que les médicaments seuls.
Les antidépresseurs peuvent réduire les symptômes plus vite, mais l’arrêt du traitement s’accompagne souvent d’un risque de rechute, si la dimension psychologique n’a pas été travaillée.
C’est pourquoi les recommandations insistent sur une approche combinée : médication si nécessaire, mais associée à une psychothérapie structurée pour consolider les acquis et apprendre à gérer la peur durablement.
En d’autres termes, les médicaments peuvent aider à “baisser le volume” de la peur, mais c’est la thérapie qui rééduque l’alarme.
Contre-indications, accoutumance et dépendance
Comme pour tout traitement médicamenteux, il est essentiel d’être accompagné par un médecin (psychiatre ou généraliste formé).
Certaines molécules peuvent être contre-indiquées en cas de grossesse, de pathologies cardiaques, de troubles du sommeil ou d’autres traitements en cours.
Les benzodiazépines, en particulier, nécessitent une vigilance accrue : elles ne doivent jamais être interrompues brutalement et doivent être intégrées dans un plan de sevrage progressif si elles ont été utilisées sur le moyen terme.
L’objectif n’est pas de supprimer un symptôme, mais de reconstruire une stabilité intérieure sans dépendance chimique.
La psychothérapie reste cruciale
Même quand un traitement médicamenteux est mis en place, la psychothérapie demeure indispensable.
Elle seule permet de traiter la cause du trouble (les schémas de peur, les évitements, les croyances anxieuses) et d’acquérir les compétences thérapeutiques nécessaires pour ne plus rechuter.
La médication peut accompagner le chemin, mais ne peut pas le remplacer
Dans l'idéal, les prescriptions devraient être faites par le médecin, en coordination avec le psychologue chargé d'effectuer la psychothérapie, cela afin de maximiser l'efficacité thérapeutique.
Mon retour clinique
Après plus de quinze ans de pratique, j’ai accompagné de nombreuses personnes souffrant d’agoraphobie.
Ce que j’observe, c’est qu’il ne s’agit jamais simplement “d’une peur des lieux”, et que cette peur n'est jamais injustifiée.
On finit toujours par trouver des explications
Beaucoup de patients ont essayé différentes méthodes les unes après les autres, sans arriver à des résultats durables ou complets.
C’est ce constat qui m’a conduit à mettre en place un programme de thérapie dédié à ces troubles que sont l'agoraphobie, le trouble panique et le trouble anxieux généralisé.
Ce programme est "un tout" structuré de A à Z pour traiter ces troubles.
Il se fonde sur la combinaison de ces trois approches (et de différents outils), cela afin de maximiser l’effiacité thérapeutique :
- Comprendre les mécanismes de la peur et de la panique ;
- Apprendre à gérer les sensations et les pensées anxieuses ;
- Traiter les racines émotionnelles (traumatiques) qui entretiennent la peur.
On traite ainsi toutes les dimensions du problème : cognitive, émotionnelle et comportementale.
Et c'est ainsi que j'ai pu obtenir les meilleurs résultats avec mes patients.
Dans la grande majorité des cas, les patients retrouvent une autonomie complète, alors qu'ils étaient limités pour certains depuis des décennies.
Bien sûr, chaque parcours est unique, mais le chemin reste le même : réapprendre à se sentir en sécurité, où que l’on soit.
📍 Pour aller plus loin :
J’ai conçu une série de 4 vidéos explicatives gratuites pour vous permettre de mieux comprendre les causes de vos troubles, ansi que le programme de thérapie que j'ai conçu.
→ [S’inscrire pour voir les 4 vidéos]
Sources
- DSM-5-TR (APA, 2022) : critères diagnostiques du trouble panique et de l’agoraphobie.
- ICD-11 (OMS, 2022) : descriptions cliniques et critères de diagnostic (chapitre F40-F41).
- NICE CG113 : Generalised Anxiety Disorder and Panic Disorder in Adults (with or without Agoraphobia) — recommandations cliniques (NHS, UK).
- National Institute of Mental Health (NIMH) : Agoraphobia overview and treatment recommendations.
- Cochrane Reviews : méta-analyses sur l’efficacité des TCC et des formats d’exposition dans l’agoraphobie.
- StatPearls – NCBI : Agoraphobia – Clinical Review (actualisation 2024).
- Mayo Clinic : Agoraphobia — Symptoms, Causes and Treatment.
- Merck Manuals (MSD) : Agoraphobia — Clinical Features and Management.
- HAS (France) : Prise en charge des troubles anxieux et paniques chez l’adulte.
- Contenu original de Karim Fathi-Berrada
Crises d'angoisse, attaque de panique, anxiété généralisée, agoraphobie
Si vous êtes touché par :
- des crises d'angoisse récurrentes ;
- des attaques de panique ;
- de l'anxiété généralisée ;
- de l'agoraphobie ;
- d'autres phobies associées à ces troubles...
Vous pouvez consulter le livret PDF du programme de thérapie que je propose pour ces troubles.
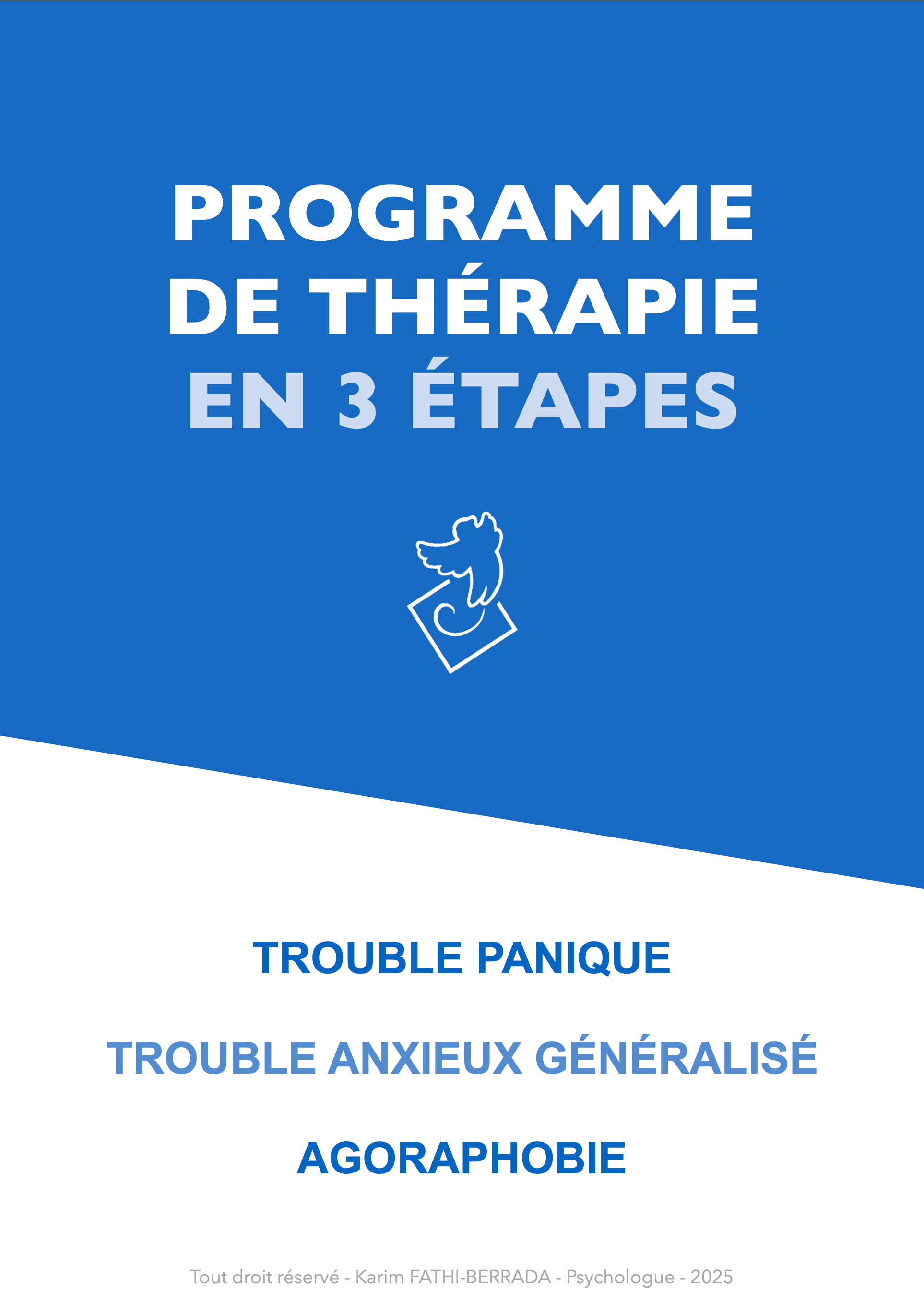




.png)
.png)



